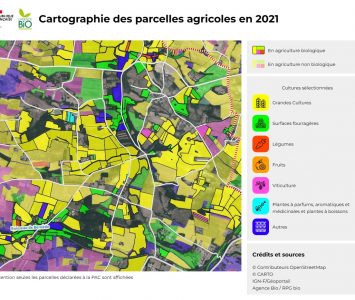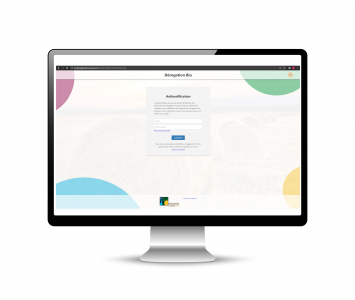Principes généraux, règles spécifiques, règles détaillées : comment s’y retrouver dans la réglementation relative à l’agriculture biologique ?
La réglementation relative à la production biologique est essentiellement produite par l’Union européenne. Le règlement (CE) n°834/2007 du Conseil du 28 juin 2007, dit règlement de base, énonce d’une part les principes généraux de la production biologique et d’autre part les règles spécifiques. Par exemple, assurer un niveau élevé de bien-être animal est un principe général alors que la prévention des maladies fondée sur la sélection des races et des souches et sur les bonnes pratiques d’élevage (qualité élevée des aliments pour animaux, exercice, logement adapté…) est une règle spécifique à l’élevage.
Règles détaillées européennes
Au-delà de ces principes généraux et de ces règles spécifiques, il existe en outre des règles détaillées : c’est le règlement (CE) n°889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008, dit règlement d’application, qui les définit en fixant des conditions concrètes d’application. Exemple : l’article 22 de ce texte énonce les règles de préparation des aliments destinés aux animaux terrestres, notamment la liste des matières premières et additifs utilisables et l’interdiction de solvants chimiques. Dans ce cas précis, les normes sont communes à toutes les espèces.
Toutefois, dans d’autres cas, comme pour les pratiques d’élevage, le logement, ou la densité de peuplement des animaux, une règle commune n’est pas adaptée. Une règle détaillée vient donc fixer les surfaces minimales intérieures et extérieures pour les bâtiments d’élevage de cinq espèces : bovins, équidés, ovins, caprins et porcins.
Qu’en est-il des productions hors règles détaillées ?
La certification de productions non couvertes par des règles détaillées est permise et peut prendre plusieurs formes : un État membre peut ainsi fixer des règles nationales ou reconnaître des normes privées pour les opérateurs produisant sur son territoire. En France, c’est la première option qui a été retenue : les autorités compétentes ont établi un corpus de règles détaillées à l’égard de certaines productions (lapins, escargots, autruches) qui viennent s’ajouter aux productions déjà couvertes par le règlement n°889/2008. Ces règles sont regroupées au sein d’un cahier des charges français (CCF), homologué par arrêté interministériel. Elles revêtent un caractère obligatoire.
La réglementation nationale peut donc venir compléter la réglementation européenne en précisant même des points qui demeurent insuffisants. Pour l’abattage des lapins par exemple, le CCF exige que la distance et le temps de transport vers le lieu d’abattage soient limités au maximum : transport sans halte vers un des abattoirs les plus proches, abattage dans la journée de l’enlèvement.

Et pour les autres productions ne rentrant pas dans ces cadres ?
Un opérateur doit quoi qu’il arrive se conformer aux principes généraux et aux règles spécifiques au secteur concerné. Si ces conditions sont remplies, il pourra commercialiser ses produits en bio. Il appartient aux organismes certificateurs de contrôler le respect de la réglementation européenne. Mais, en l’absence de règles détaillées, ce contrôle n’est pas simple. Sa nature a été précisée par le Comité national de l’agriculture biologique (Cnab) en septembre 2017. Le Cnab et l’Inao veillent à la conformité des conditions de production proposées par un opérateur, sans nécessairement être étendues aux autres. Sur le terrain, c’est l’organisme certificateur qui attestera du bon respect des règles validées.
Olivier Catrou, responsable du pôle AB, Inao